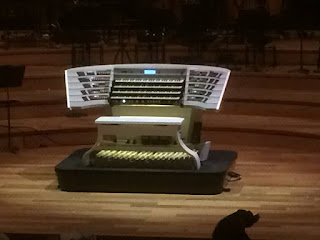Stephen Kovacevich. Photo : DR
Pour son soixante-quinzième anniversaire, qu'il a célébré lundi 2 novembre 2015 (1), rejoint par son ex-épouse, Martha Argerich, dans la salle où il a fait ses débuts en 1961 grâce à son professeur, Myra Hess, le Wigmore Hall de Londres, Stephen Kovacevich a présidé le Concours Marguerite Long 2015 qui vient de se dérouler à Paris au mois d’octobre et qui n’a pas attribué de Premier prix. A cette occasion, les organisateurs du concours conjointement à Universal Classics m’ont permis d’aller à la rencontre de cet immense artiste américain pour m’entretenir avec lui en son domicile londonien.
Stephen Kovacevich est notamment un remarquable interprète de Beethoven, qu’il investit jusqu’au plus secret de chaque note en lui donnant limpidité, sérénité, grandeur, onirisme exhaussés par un son ample et chaud qui lui est propre. Rencontré dans son cottage londonien où il faut retirer ses chaussures si l’on tient à entrer, confortablement assis non loin de son Steinway de concert couvert d’un tissu coloré, chaleureux et plein d’humour, Stephen Kovacevich ne paraît pas son âge. Né le 17 octobre 1940 à Los Angeles de père croate et de mère américaine, il a donné son premier récital à 11 ans. A 18 ans, il s’est rendu en Angleterre pour étudier avec Myra Hess. Depuis lors, il réside à Londres. Ce qu’il retenu de Myra Hess ce n’est pas tant le travail que le son, sa profonde connaissance des partitions et des indications qu’elles contiennent. Quand il étudiait en Californie, Kovacevich ne comprenait pas vraiment le nuancier, particulièrement celui de Beethoven. C’est à son contact qu’il a commencé à le saisir. Il s’est aussi formé à l’écoute d’Otto Klemperer. S’il n’a pas joué sous la direction de l’impressionnant chef allemand, cela lui paraît sans importance car il dirigeait les plus grands Beethoven qu’il a entendus de sa vie, le son Klemperer étant unique et impressionnant de noblesse. Ce n’est donc pas avec Klemperer que Kovacevich a donné son premier concerto mais avec un anglais. « C’était aux Proms de Londres avec Malcolm Sargent dans le 4e Concertode Beethoven, se souvient-il. A 23 ans, j’ai joué le même concerto avec Colin Davis en concert à Liverpool. Dans les dix ans qui ont suivi, nous avons enregistré ensemble les concertos de Beethoven, Bartók, Brahms, Grieg, Schumann… » Mais il faut aussi écouter ses Variations Diabelli (son premier disque, à 27 ans) et sonates de Beethoven, ses Brahms, ses duos avec Martha Argerich, qui fut sa femme et dont il a eu une fille aujourd’hui photographe (2). Tous enregistrements qui viennent d’être réédités en un coffret (voir le compte-rendu ci-dessous, après l’interview).
Depuis 1984, Stephen Kovacevich est également chef d'orchestre. Il a fait ses débuts à la tête du Houston Symphony Orchestra, avant de diriger entre autres le Chamber Orchestra of Europe, le Royal Philharmonic Orchestra, le BBC Symphony...
B. S.
1) En France, Stephen Kovacevich se produira au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence le 24 mars 2016 et à la Philharmonie de Paris le 15 avril 2016
° °
°
Stephen Kovacevich. Photo : DR
Entretien avec
STEPHEN KOVACEVICH
Bruno Serrou : Qu’est-ce ce qui vous a incité à accepter de présider le concours Marguerite Long 2015 ?
Stephen Kovacevich : J’aime écouter les jeunes musiciens, et je suis heureux qu’un certain nombre viennent travailler chez moi. Il en est d’incroyables. Je donne des cours privés. J’enseigne à Verbier, tous les deux ans. J’y serai l’année prochaine. Les standards y sont très élevés.
B. S. : Pour votre part, vous n’avez jamais tenté de concours ?
S. K. : Si. Le Reine Elisabeth de Belgique. J’avais 19 ans. Mais Rien n’est arrivé. J’étais trop nerveux, devant le clavier. Les deux grands concours de mon temps étaient l’Elisabeth et le Tchaïkovski. Pour les autres, la notoriété était moindre.
B. S. : Pensez-vous qu’il est important aujourd’hui pour un jeune musicien de remporter un concours ?
S. K. : Aujourd’hui, c’est la seule manière pour un jeune artiste d’être entendu. Quand j’ai commencé, j’ai loué le Wigmore Hall de Londres pour trois soirées réparties sur en deux saisons, et j’ai eu de la chance parce que mon professeur, Myra Hess, m’y a aidé. Mais aujourd’hui, si vous louez une salle personne ne vient. En fait, le concours met tout le monde à égalité, et je pense que vous n’êtes pas obligé de jouer la Méphisto-Valse pour gagner, vous pouvez aussi jouer Beethoven, Schubert ou Brahms. Le concours est moyen plus sophistiqué, plus civilisé qu’autrefois. Mon premier vrai jury remonte à il y un an, lorsque Nelson Freire m’a demandé d’être président de son concours à Rio de Janeiro. J’étais très content, d’autant plus que je découvrais Rio. J’aime aussi Paris, et je suis heureux d’y séjourner quelques jours grâce au Concours Marguerite Long. Je pense que c’est la seule voie pour un jeune de savoir ce qu’il vaut. Même s’il ne gagne pas il peut faire impression. Dans des grands concours comme le Chopin, le Tchaïkovski, le Leeds, le Cliburn, vous n’êtes pas obligé de gagner, quelque part vous jouez devant des professionnels, devant un public. Vous gagnez, ok, mais si vous ne gagnez pas, vous pouvez susciter l’intérêt. Vous développez aussi votre répertoire. Il n’est donc pas nécessaire de gagner.
B. S. : Vous êtes californien, vous êtes venu au Royaume Uni pour travailler avec Myra Hess. Comment avez-vous découvert cette grande pianiste ?
S. K. : Elle jouait souvent à San Francisco avec l’orchestre symphonique de la ville. Et la première fois que je l’ai entendue, j’ai apprécié mais pas plus. La deuxième fois que je l’ai écoutée, je trouvé que c’était vraiment une très-très grande interprète. J’avais un ami qui la connaissait, il m’a présenté à elle. Je lui ai joué l’Opus 109 de Beethoven, et elle a accepté que je vienne à Londres. Pour ce faire, mon université m’a attribué une bourse de deux ans pour m’y rendre.
B. S. : Pendant vos études avec Myra Hess, donniez-vous des concerts publics ?
S. K. : Je me limitais à l’étude.
B. S. : Comment était votre professeur ?
S. K. : Elle excellait dans Beethoven, Schubert, Brahms. Dans Mozart aussi… Ce que j’ai retenu d’elle ce n’est pas tant le travail que le son. Elle connaissait par cœur les partitions et toutes les indications qu’elles contenaient. Quand j’étudiais en Californie, je ne comprenais pas vraiment toutes les nuances des œuvres, particulièrement chez Beethoven. Je n’ai commencé à les comprendre qu’à son contact. A Londres, je me suis également formé en écoutant Otto Klemperer. Je n’ai pas joué avec lui, mais cela n’a pas d’importance parce qu’il dirigeait les plus grands Beethoven que j’ai entendus de ma vie. Le son de Klemperer est unique et il est impressionnant de grandeur.
B. S. : Au contact de Myra Hess et d’Otto Klemperer, vous avez été à bonne école pour devenir un grand interprète Beethoven
S. K. : Pourtant, quand j’enregistrais chez Philips, je ne connaissais pas toutes les sonates de Beethoven. C’est pourquoi je ne les ai toutes enregistrées qu’une fois chez EMI. Toutes ne m’intéressaient pas encore (rires). Je n’aimais que la dernière période, et je n’ai pas joué la Sonate « Hammerklavier » avant d’avoir 50 ans. Avant, je ne pensais pas être capable de la jouer. Mon véritable amour quand j’avais 20-30 ans étaient les Diabelli.
B. S. : Avec les Diabelli, vous commencez avec Haydn et vous finissez avec Schönberg...
S. K. : Oui… Mais je n’aime pas Haydn (rires).
B. S. : Sous la direction de qui avez-vous donné vos premiers concertos de Beethoven ?
S. K. : Le premier chef avec qui je me suis produit a été Sir Malcolm Sargent. C’était aux Proms de Londres dans le Quatrième Concerto de Beethoven. Puis, à 23 ans, j’ai rencontré Colin Davis, avec qui j’ai joué ce même Quatrième Concerto de Beethoven à Liverpool, avec le Liverpool Philharmonic. Le contact avec Colin a été très fort. Et dans les dix ans qui ont suivi nous avons fait tous les disques pour Philips, le Deuxième Concerto de Bartók en 1968 et le Cinquième Concerto de Beethoven en 1969. Les derniers seront les deux Concerto de Brahms, en 1979. Colin avait le « feeling » avec Berlioz, il « possédait » littéralement Berlioz, au point de voir comme Berlioz. Mais Berlioz était trop musicien pour écrire pour le piano (rires).
B. S. : En revanche vous jouez Sir Michael Tippett, qui était aussi un ami de Colin Davis.
S. K. : Oui. J’ai joué son concerto sous sa direction. J’estimais que les indications métronomiques de Tippett dans son premier mouvement étaient beaucoup trop rapides. Mais, jugeant que c’était la volonté du compositeur, je me suis senti obligé de jouer comme il l’avait noté. Aussi, à la première répétition, j’ai interprété le mouvement au tempo indiqué, mais il m’a dit : « Pourquoi jouez-vous si vite ? » Je lui ai répondu « Mais, Sir Michael, c’est ce qu’il y a sur votre partition ». Il m’a répliqué : « Cher garçon, n’y prêtez aucune attention » [Stephen Kovacevich imite la voix posée et légèrement voilée de Tippett]. Bartók était un maniaque pour ses tempi, pourtant, quand vous écoutez ses enregistrements, il ne fait pas ce qu’il a écrit.
B. S. : Quel est le chef d’orchestre qui vous a le plus impressionné ?
S. K. : Probablement Otto Klemperer, mais aussi Arturo Toscanini, et j’adore les enregistrements Strauss de Fritz Reiner. Ils sont absolument incroyables. Ils sonnent dans mes oreilles quand je joue au piano, j’ai le son Strauss de Reiner.
B. S. : Jouez-vous la Burleske de Richard Strauss ?
S. K. : Une pièce magnifique, mais je ne la joue pas.
B. S. : Pourquoi ?
S. K. : Je ne sais pas... J’ai entendu d’extraordinaires Burleske, celle du pianiste suisse Pierre Montesi il y a un an, mais aussi Martha [Argerich], Byron Janis...
B. S. : Comment choisissez-vous votre répertoire ?
S. K. : Uniquement la musique que j’aime. Bartók pendant un temps a été mon préféré, j’ai joué et enregistré à la fin des années 1960-début des années 1970 ses trois Concertos, sa Sonate pour deux pianos et percussion, En Plein air, le sixième livre du Mikrokosmos et la Sonatine.
B. S. : Choisissez-vous les compositeurs ou les œuvres ?
S. K. : Par exemple, pour Bartók, je suis d’abord tombé amoureux de son Deuxième Concerto, et j’ai finalement abordé le Premierpuis le Troisième… J’ai suivi la même voie pour Beethoven, je suis d’abord tombé amoureux des Diabelli, pour Brahms ce fut le Concerto en ré mineur. En fait, c’est une seule œuvre qui m’attire vers un compositeur.
B. S. : Qu’en est-il de Jean-Sébastien Bach ?
S. K. : Je l’adore, mais je ne joue de lui que la 4e Partita et quelques Préludes et fugues. J’aime les concertos de Haydn, mais je n’apprécie guère ses sonates.
B. S. : Vous jouez Beethoven partout et souvent. Sont-ce les organisateurs qui vous y invitent ou est-ce vous qui le voulez ?
S. K. : C’est moi qui le veux. Je joue aussi beaucoup Schubert, ses deux dernières sonates très-très-très souvent. Surtout maintenant. Elles signifient beaucoup pour moi.
B. S. : Schubert est difficile à jouer en raison des da capo, que d’aucuns jugent longs quand ils sont faits et plus longs encore lorsqu’ils ne le sont pas…
S. K. : C’est amusant… J’ai joué à Zagreb voilà deux jours la dernière Sonate de Schubert, et je n’ai pas fait les da capo. J’aime pourtant les faire, mais je ne les fais qu’en fonction de la façon dont je perçois le public. Je n'ai pas de position tranchée. J’aime faire les reprises, bien sûr, mais tout dépend de la salle. Si je la sens concentrée, je les fais. Un chef m’a dit une fois à propos d’un concerto : « Si vous prenez le premier mouvement, si vous le répétez c’est trop long ; si vous ne le reprenez pas, c’est trop court ». Et c’est vrai. Je suis content de répéter, mais je ne répète pas toujours.
B. S. : Jouez-vous les lieder de Schubert ?
S. K. : Je ne les ai jamais donnés en public. J’aime les lieder de Schumann, Grieg, Bartók, Brahms, moins ceux de Beethoven. Mes préférés sont ceux de Schumann.
B. S. : Préférez-vous vous produire avec un chanteur ou avec des instrumentistes ?
S. K. : C’est totalement différent. Je pense que ma plus grande joie est de jouer avec des violonistes, des violoncellistes et autres instrumentistes.
B. S. : Claudio Arrau disait que pour lui le piano devait être chant, celui-ci étant le plus important dans la musique, estimant le piano comme une voix comme une autre.
S. K. : Oui. C’est vrai, et ma joie est de jouer avec un violoniste avant tout.
Avec Martha Argerich. Photo : DR
B. S. : Vous aimez à vous produire avec des artistes particuliers ?
S. K. : Jeune, j’étais heureux de jouer avec Joseph Suk. Aujourd’hui, la violoniste avec qui j’aime le plus jouer est Alina Ibragimova. Nous avons fait ensemble la Sonate en sol majeur de Brahms. Ce fut un véritable rêve. Parmi les violoncellistes, Lynn Harrell, Truls Mörk, I love. J’aime aussi beaucoup Kyung-wha Chung, avec qui j’ai fait beaucoup de choses.
Le coffret "Stephen Kovacevich, The Complete Philips Recordings". Photo : (c) Bruno Serrou
B. S. : Qu’est-ce qui est le plus important, pour vous, entre le disque et le concert ?
S. K. : Les deux ! Ce sont en effet deux choses complètement différentes, qui sont aussi importantes l’une que l’autre. Par exemple, lorsque j’entends les disques de Rachmaninov, ils sont absolument incroyables. Nous avons besoin de connaître cela. Rachmaninov est un géant, a King. Il ne nous a pas légué que ses interprétations de sa propre musique, mais aussi des Impromptusde Schubert, qui sont les plus grands Schubert que j’ai entendus. Personne ne joue Carnaval de Schumann comme lui, cette œuvre sous ses doigts est absolument étonnante.
B. S. : Jouez-vous Rachmaninov ?
S. K. : Je commence à le jouer. Après une longue attente (rires). Ses Danses symphoniques avec Martha [Argerich], par exemple. C’est merveilleux à jouer pour un pianiste. Cela suscite un énorme plaisir.
B. S. : Plus que Prokofiev, par exemple ?
S. K. : C’est différent. Pourquoi - et c’est très français - vouloir à tout prix faire des distinctions ou des classifications entre les compositeurs ? Chez Prokofiev, ce qu’il y a d’extraordinaire ce sont ses Sixième et Huitième Sonates, ses deux Sonates pour violon et piano, son Roméo et Juliette est phénoménal, ses deux Concertos pour violon…
B. S. : Pour ce qui concerne la musique contemporaine, vous avez joué Tippett, mais jouez-vous d’autres compositeurs ?
S. K. : John Taverner m’a écrit une pièce. Mais plus contemporains, non. Je ne les comprends pas totalement. J’aime la musique de George Benjamin et quelques pièces de Harrison Birtwistle comme le Triopour violon, violoncelle et piano ; un très beau trio. J’aime aussi James Dillon, mais je ne le joue pas. La musique de Ligeti est très belle et je l’aime beaucoup, mais je ne la joue pas non plus. Parce que beaucoup de jeunes pianistes peuvent le faire bien mieux que moi.
B. S. : Aujourd’hui, outre Rachmaninov, avez-vous dans votre viseur d’autres compositeurs que vous aimeriez jouer ?
S. K. : Oui je commence à en apprendre, les Etudes-Tableaux notamment. Mais pour le moment il est mon seul nouvel amour (rires). Je joue aussi Messiaen, le Quatuor pour la fin du Temps.
B. S. : Il semble que vous n’avez jamais rencontré de difficulté à mener votre carrière.
S. K. : J’ai eu cette chance, en effet. J’ai cependant dû m’arrêter à 35 ans. J’ai pensé que je ne pourrais plus jamais jouer. J’étais trop nerveux. Lorsque j’ai recommencé à me produire en public, les deux premières années ont été très difficiles, car j’ai donné de très mauvais concerts. Mais, petit à petit, ma confiance est revenue. C’était un problème psychologique. Lorsque j’étais sur scène, c’était une véritable torture. Jouer en public est encore un problème, mais cela va beaucoup mieux.
B. S. : Quand vous montez sur scène, voyez-vous le public ou seulement votre piano ?
S. K. : Je ne sais pas… Je vois tout, je pense. Parfois c’est encore difficile mais pas si mal maintenant, avant cela l’était davantage.
B. S. : Combien de concerts donnez-vous par an ?
S. K. : Maintenant, je fais très attention. Je joue seulement vingt à trente fois par an, au maximum, contre cinquante à soixante auparavant. J’ai trop joué, et trop souvent. Tous les jeunes jouent trop. Ils deviennent des machines, et les agents en sont responsables au premier chef.
B. S. : Que représente Marguerite Long, à vos yeux ?
S. K. : Je pense à ses collaborations avec les compositeurs, comme Ravel. Sur elle-même, je ne sais pas, je sais qu’elle est une importante pianiste française, probablement, même si sa façon de jouer ne m’est pas proche. Mais elle compte parce qu’elle était proche de Ravel, de Debussy, de Fauré. Là est l’important. En revanche, il y a une pédagogue française que je n’aime pas du tout, c’est Nadia Boulanger. Elle est si stupide… Pas ses étudiants, mais elle, oui. Beaucoup de gens l’aiment bien, elle était intelligente, mais l’intelligence c’est la moitié, maximum, pour la musique, elle ne fait pas tout.
B. S. : Vous qui n’enseignez pas dans des conservatoires ou autres institutions pédagogiques, comment choisissez-vous vos élèves ?
S. K. : Ils m’appellent et ils viennent ici, chez moi. La plupart sont très bien, et jouent déjà en concert. Je les connais par leurs enregistrements ; je les ai entendus en concert. Nous passons des moments fantastiques ici. Je n’enseigne pas que le piano, mais aussi par exemple le Concerto pour violon de Sibelius ; des trios, des quatuors constitués viennent vers moi. C’est merveilleux.
B. S. : Leur dites-vous comment ils doivent travailler ?
S. K. : Habituellement, ils viennent ici parce qu’ils ne comprennent pas complètement quelque chose. Bien sûr, il nous faut travailler dur, mais la seconde chose que vous apprenez seulement par vous-même est qu’il faut acquérir un fort degré d’introspection en étant dans l’œuvre pendant des semaines, voire des mois.
B. S. : Quel est votre vision de l’avenir de la musique ?
S. K. : Je connais de nombreux merveilleux jeunes pianistes qui ont un riche potentiel, mais qui n’ont pas d’avenir parce que personne ne les connait. Ils n’ont pas d’argent. C’est comme ça. On a besoin de beaucoup de chance.
B. S. : Mais ces jeunes qui viennent vous voir, travaillent avec vous, vous-même pouvez parler d’eux.
S. K. : C’est ce que je fais. Je connais une excellente jeune pianiste, Zlata Chochieva… Vous connaissez André Furno ? Je lui ai parlé d’elle, elle a fait un sensationnel cd consacré aux Etudes de Chopin, un disque absolument magnifique. J’ai appelé André, il a écouté le disque, et il lui a offert un récital à Paris. Un autre a suivi à Berlin…
B. S. : D’où viennent vos élèves ?
S. K. : De partout. Je n’ai pas de français de ce niveau. Au plus haut niveau, j’ai des Slaves, Russes, et Géorgiens, des Chinois, des Japonais, un Américain dont la famille est polonaise. Peut-être ce dernier va-t-il remporter un concours...
B. S. : Que pensez-vous du fait que les Asiatiques aiment la musique occidentale ?
S. K. : Les musiciens japonais se font de plus en plus expressifs. Je joue avec les orchestres nippons, et ils tous sont excellents. Je me suis produit voilà trois ans avec un chef français, Sylvain Cambreling, et un orchestre japonais, le Yomiuri Nippon Symphony Orchestra. C’est la première fois qu’une formation symphonique de ce pays jouait non pas seulement correctement mais avec une grande beauté sonore et avec compréhension. Il y a trois ans, encore, à Verbier, un pianiste japonais joua la Quatrième Ballade de Chopin, je n’ai jamais entendu mieux, ce fut extraordinairement musical. Les Japonais évoluent bien ; en Chine vous avez des violonistes absolument merveilleux.
B. S. : Allez-vous au concert écouter vos collègues ?
S. K. : Je vais parfois les écouter. Ce qui m’attire dans les salles de concert en tant qu’auditeur c’est parfois le répertoire, parfois la personne. On ne sait pas pourquoi les artistes réussissent des choses merveilleusement, d’autres qu’ils ratent. C’est inexplicable.
Photo : (c) Medici.tv
B. S. : Pour votre part, vous excellez partout…
S. K. : Non. En fait je choisis ce que je joue.
B. S. : Combien d’œuvres avez-vous à votre répertoire ?
S. K. : Aucune idée. Par exemple, j’aime Chopin, mais je ne pense pas avoir le son qui lui est adapté. Je ne le joue donc pas. J’ai enregistré quelques pages de lui, Polonaise op. 61, Impromptu op. 51/3, Mazurkas op. 63, Barcarolle op. 60, Nocturnes op. 62, des Valses avec celles de Ravel… Je pense que j’aimerais travailler les Mazurkas... J’en connais trente sur cinquante-huit. Je les possède assez bien. Mais avec Chopin, le son est complètement différent du mien. Moi qui ai tant joué Beethoven, Chopin n’a rien à voir. Je joue tous les Brahms de la maturité. Les œuvres courtes de Brahms sont de grandes œuvres, et elles sonnent comme un orchestre.
B. S. : Quelles sont vos affinités avec Schumann ?
S. K. : J’aime Schumann. Je joue son Concerto, sa Sonate en fa dièse, sa Fantaisie, mais pas beaucoup. Je veux apprendre ses Kreisleriana. Les miniatures de Schumann sont probablement plus difficiles que celles de Beethoven et de Brahms. Parce que le son… Oui, je pense que Kreisleriana est une œuvre géniale, mais le son, l’ambiance ne sont pas directs. Là où Brahms est en résonance, Schumann est en intimité. Le phrasé de Brahms est long, celui de Schumann est plus court. Mes deux concertos favoris sont le Premierde Brahms et le Deuxième de Rachmaninov. L’un de mes grands aînés et compatriotes, William Kapell (1922-1953), jouait merveilleusement le Deuxièmede Rachmaninov…
B. S. : N’est-il pas trop difficile pour un pianiste d’avoir tout ce back ground ?
S. K. : Au contraire, c’est bien. Nous avons de grands pianistes. Van Cliburn (1934-2013) était exceptionnel quand il était jeune. Après quelque chose a dû lui arriver, il a perdu sa confiance en lui. Il a joué à Moscou les Deuxième et Troisième Concertos de Rachmaninov, c’était fantastique. Il ne jouait pas comme les autres, pas très vite, mais sa personnalité était incroyablement passionnée. C’était un très grand pianiste, mais soudain quelque chose est arrivé, je ne sais pas quoi. C’est bien d’avoir toute cette histoire du piano derrière soi, quand on est pianiste. Cela inspire.
B. S. : Et pour trouver sa propre personnalité ?
S. K. : J’ai appris de tout le monde. Votre personnalité vous est propre. Je n’ai pas peur d’écouter tout le monde. Je pense qu’il est important de les connaître.
B. S. : Vous vous êtes mis à la direction d’orchestre…
S. K. : Oui, et je dirige beaucoup.
B. S. : Qu’est-ce qui est important de posséder pour diriger ?
S. K. : Vous devez avoir le geste, être capable de vous exprimer. Je dirige les œuvres que je veux, les symphonies de Brahms, celles de Beethoven, la Quatrième de Sibelius, quelques pages de Wagner, des œuvres de Tchaïkovski… Je voulais faire ces pièces, et je les ai faites.
B. S. : Vous dirigez aussi du piano ?
S. K. : Oui. J’ai enregistré avec l’Orchestre de Chambre d’Australie l’Empereur de Beethoven. Ce Cinquième Concerto est facile à diriger du piano. Le Quatrième est le plus difficile, parce qu’il est très flexible, mais c’est possible. Mais je ne dirige plus, en ce moment. J’ai arrêté. Par choix personnel.
B. S. : Le piano vous suffirait-il ?
S. K. : Il est plus que suffisant. J’ai envie de faire de la musique de chambre, la Sonate n° 2 pour violon et piano de Bartók, une pièce vraiment magnifique. Je veux la jouer avec Alina Ibragimova.
B. S. : Que pensez-vous de la situation de la musique aujourd’hui ?
S. K. : Je ne sais pas pourquoi le milieu musical se fait de plus en plus alarmiste… Les gens continuent à se rendre au concert. Par exemple à Paris, le public est plus jeune qu’à Londres. Je ne sais pas pourquoi. Quand je donne un récital à Paris, il y a beaucoup de jeunes spectateurs. Ce n’est pas comme à Londres. Je pense… Non, la musique est vivante, preuve en est le fait que les jeunes pianistes, les jeunes violonistes sont merveilleux.
B. S. : Aux Etats-Unis, où vous vous produisez régulièrement, la musique où en est-elle ? S’exprime-t-elle exclusivement dans les universités ?
S. K. : Non. Certes, il y a toujours plus de musique dans les universités qu’ailleurs, mais moins maintenant. New York a une vie musicale très importante.
B. S. : Vous n’êtes jamais retourné vivre aux Etats-Unis. Préférez-vous Londres à San Francisco ?
S. K. : Je suis venu à Londres pour étudier, et mes enfants y sont installés. J’aime l’Europe. Je vis à Londres parce que mon français est très mauvais. En Angleterre, il y a beaucoup d’excellents orchestres, y compris hors de Londres : Birmingham, Liverpool sont de très bons orchestres. Je me produits une ou deux fois par an à Londres, voire trois. Mais je ne joue pas beaucoup de concertos.
B. S. : Quel est l’endroit où vous aimez le plus vous produire ?
S. K. : Je me sens très bien à Paris. Ainsi qu’en Scandinavie. A New York, j’aime jouer au Metropolitan Museum of Art, c’est une très bonne salle. Ma salle parisienne favorite est Gaveau. Le son est magnifique. C’est le meilleur de Paris.
B. S. : Quels sont les chefs d’orchestre avec qui vous aimez vous produire, aujourd’hui ?
S. K. : Je n’ai plus de relations aussi privilégiées aussi fortes qu’avec Colin Davis autrefois.
B. S. : Vous ne souhaitez plus enregistrer de concertos ?
S. K. : Non, seulement de la musique de chambre. Et peut-être quelques œuvres pour orchestre.
B. S. : En dehors de la musique, qu’aimez-vous dans la vie ?
S. K. : Le tennis et la cuisine indienne. Je connais quantité d’excellents restaurants indiens à Paris. A Londres aussi, bien sûr. Pour le tennis, je suis inscrit dans un club londonien, pas loin de chez moi, et je joue deux fois par semaine.
B. S. : Le tennis n’est pas dangereux, pour un pianiste ?
S. K. : Non, si l’on joue régulièrement, ce n’est absolument pas dangereux.
B. S. : Travaillez-vous votre piano tous les jours ?
S. K. : Chaque jour, en effet. De 10h30 à 19h. Pas toutes les secondes, mais quand j’ai fini une pièce j’en fais une autre. Depuis mon accident vasculaire cérébral, il y a six ans, je dois pratiquer mon piano tout le temps, pour les connexions cérébrales et gestuelles.
B. S. : Vous travaillez aussi quand vous êtes en vacances ?
S. K. : Je prends de très courtes vacances, cinq jours tout au plus. Sinon je joue tous les jours, sur ce Steinway.
B. S. : Est-il important de jouer par cœur ou avec partition ?
S. K. : Je préfère jouer par cœur, mais quand je fais de la musique de chambre, j’utilise évidemment les partitions. Mais je n’aime pas jouer comme Richter.
B. S. : Etes-vous un adepte des intégrales ?
S. K. : Je n’ai jamais joué toutes les sonates de Beethoven dans une même série. Je ne le peux pas. Cela m’intéresse, mais ce n’est pas ma façon de travailler. Je dois travailler si dur pour bien jouer, que je ne peux pas faire une intégrale d’un coup, je n’ai pas le temps. Je ne suis jamais pleinement content de mes prestations. Il y a deux ans, j’ai donné un récital qui m’a comblé, c’était l’un de mes meilleurs concerts que j’ai joué de ma vie. J’en ai été très heureux, bien sûr. Mais c’est très rare de jouer ainsi. Si je joue merveilleusement, cela m’encourage. Je me dis que je peux faire mieux encore. C’est pourquoi je continue à jouer. Je dois faire la Sonate en si bémol de Schubert ici, à Londres, le 2 novembre, peu après mon soixante-quinzième anniversaire (1), et ce sera peut-être merveilleux, c’est possible, parce que je travaille dur et advienne ce que pourra.
B. S. : Travailler trop dur peut être risqué…
S. K. : Oui, mais je pense savoir comment m’y prendre.
B. S. : Quelle sensation vous procure le fait d’avoir 75 ans ?
S. K. : Je joue au tennis deux fois par semaine. Cela me maintient (rires).
B. S. : L’âge venu, avez-vous fini par adopter votre patronyme définitif ?
S. K. : Maintenant, je joue sous le nom de ma mère. Cette dernière a fait un terrifiant mariage avec un nommé Bishop. Au début de ma carrière j’ai porté le nom de mon père, puis je l’ai associé à celui de ma mère, que j’ai fini par adopter… Mais je pense que c’est mon dernier changement de nom (rires).
Recueilli par Bruno Serrou
Londres, lundi 12 octobre 2015
° °
°
CD : STEPHEN KOVACEVICH EN 25 CD DECCA
A l’occasion des 75 ans du pianiste américain, le label Decca a eu l’excellente initiative de regrouper en vingt-cinq CD les enregistrements Philips de Stephen Kovacevich, soit les quinze premières années de la carrière discographique du pianiste (1968-1983), avant qu’il rejoigne EMI. Des enregistrements pour la plupart acclamés dès leur publication, et depuis lors confortablement installés parmi les références absolues. Pensons à ses Beethoven, Schumann, Brahms, Bartók et autres duos avec Martha Argerich, dont il a été le troisième époux, sans oublier sa remarquable complicité avec le chef d’orchestre britannique Colin Davis. Parmi ses enregistrements de jeunesse, des Chopin qui constituent le seul maillon faible de cette somme malgré de poétiques Nocturneset Fantaisie-Polonaise, son concerto de Stravinski, Quintette de Dvorak, concertos et Trio avec clarinette de Mozart plus rares sous ses doigts. Un pianiste qui nous offre toujours, quels que soient le compositeur et l’époque abordés, une vision claire, prenante, philosophiquement élevée de la musique qu’il joue magnifié par un sens prodigieux du détail. Un artiste toujours remarquablement inspiré. Tous les concertos enregistrés avec Colin Davis sont d’une beauté et d’une profondeur inouïe tant l’entente entre les deux hommes est totale, que ce soit au plan des sonorités de tous les pupitres, clavier et orchestre, que l’allant, le rythme, l’intonation, les intentions.
Kovacevich est l’un des rares pianistes à avoir enregistré et à jouer régulièrement les trois cahiers de Bagatelles de Beethoven, qui sonnent sous ces doigts avec infiniment d’esprit, de grâce, de limpidité. Il est d’ailleurs parmi les grands interprètes de Beethoven, toutes époques confondues, cela dès son tout premier enregistrement, les Variations Diabelli en février 1968, l’une des versions les plus extraordinaires qui puisse se trouver. Son Concerto n° 1de Brahms est d’une ferveur toute juvénile et débouche sur un finale passionné, tandis que le Concerto n° 2 s’impose comme un modèle de fusion et de dialogue entre le soliste et l’orchestre qui corroborent le fait qu’il s’agit en fait d’une symphonie avec piano obligé. Dans les pièces pour piano solo du même Brahms, Kovacevich caractérise magnifiquement chacune d’elles, particulièrement les Variations Haendel et les Valses op. 39. Kovacevich a enregistré quatre des concertos de Mozart, les vingtième, vingt et unième, vingt-troisième et vingt-cinquième. Il exalte les mouvements lents par son chant typiquement mozartien, offrant ses propres excellentes cadences dans les Concertos n° 20, 21 et 25, Mozart n’en ayant pas écrit pour eux, contrairement au 23e. Dans le classique couplage des concertos de Schumann et de Grieg, Kovacevich accorde une attention particulière aux lignes mélodiques qu’il galvanise par la beauté de ses phrasés tout en s’avérant d’une virtuosité naturelle impressionnante. Les deux premiers concertos de Bartók rivalisent avec les versions de Mauricio Pollini et ont peu à envier à celles de Géza Anda, tandis que sa Sonate pour deux pianos et percussion avec sa compagne de l’époque, Martha Argerich, avec qui il dialogue en outre dans des pages de Mozart et de Debussy, l’unicité de leur conception et de leur rapport à l’œuvre, leur technique et leurs timbres font de ces enregistrements des réalisations de référence.
Philips a longtemps été célébré pour la qualité de ses enregistrements, et cet ensemble ne fait pas exception. Chaque disque sonne avec infiniment de naturel, sans aucun excès de dynamiques. Chaque CD reprend la pochette d’origine, à l’exception d’un disque de musique de chambre qui réunit deux albums. L’ensemble du coffret est présenté dans l’ordre alphabétique des compositeurs et non pas dans la chronologie des enregistrements et des parutions.
B. S.
25 CDs Stephen Kovacevich The Complete Philips Recordings 478 8662